|
|
|
|
 |
|
Les déchets radioactifs |
|
|
| |
|
| |
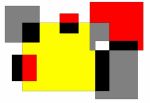
Les déchets radioactifs
On appelle déchet radioactif toute matière radioactive qui ne peut plus être ni recyclée ni réutilisée. Du fait de leur radiotoxicité, potentiellement dangereuse pour l’homme et pour l’environnement, les déchets radioactifs sont gérés de façon spécifique. Cette gestion est encadrée par la Loi. 90 % des déchets radioactifs (en volume), produits en France, disposent déjà d’une filière de gestion en stockage ultime. Les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue (HA et MA-VL) n’ont pas encore de filières définitives de stockage. Ils sont conditionnés et entreposés par leurs producteurs, dans l’attente d’un site de stockage définitif.
DÉCHETS RADIOACTIFS : DÉFINITION
Les déchets radioactifs sont d’une grande diversité : éléments issus des combustibles usés des centrales nucléaires et des activités Défense pour la force de dissuasion, matériaux issus du démantèlement d'installations nucléaires, éléments radioactifs à usage industriel (techniques de contrôle de fabrication, stérilisation) ou médical (imagerie, radiothérapie), éléments issus de la recherche nucléaire…
En France, les déchets radioactifs sont classés selon deux critères :
* Leur durée de vie, calculée en fonction de la « période radioactive » des radioéléments contenus : la période est le temps au bout duquel la quantité d’un même radionucléide est divisée par deux. Elle varie, selon les radionucléides, de quelques jours à plusieurs milliers d’années. On parle de déchets à vie courte (VC), quand la période est inférieure à 31 ans, et de déchets à vie longue (VL) au-delà.
* Leur niveau de radioactivité, exprimé en becquerels : cela correspond au nombre de désintégrations d’atomes par seconde. On parle de déchets de très faible activité (TFA), faible activité (FA), moyenne activité (MA) ou haute activité (HA).
Les différentes catégories de déchets radioactifs
En fonction de ces deux critères, il existe 5 catégories de déchets radioactifs :
* Les déchets de très faible activité (TFA) issus principalement du démantèlement des installations nucléaires : gravats, bétons, ferrailles. Leur radioactivité décroit de manière significative en une dizaine d'années. Ils représentent 27% du volume des déchets radioactifs produits en France et contiennent moins de 0,01% de la radioactivité de l’ensemble des déchets.
* Les déchets de faible et moyenne activité à vie courte (FMA-VC) : il s'agit essentiellement des déchets liés à la maintenance des installations nucléaires. Une partie provient aussi des hôpitaux ou des laboratoires de recherche. Ce sont des objets contaminés comme des gants, des filtres, des résines… Leur radioactivité décroit de manière significative en 300 ans environ. Les déchets FMA-VC constituent 63% du volume des déchets radioactifs, pour 0,02% de leur radioactivité.
* Les déchets de faible activité à vie longue (FA-VL) : cette catégorie couvre les déchets radifères (contenant du radium) provenant de minéraux utilisés dans certaines industries et les déchets de graphite issus du démantèlement des réacteurs nucléaires de 1ère génération. Les déchets FA-VL constituent 7% du volume des déchets radioactifs, pour 0,01% de leur radioactivité.
* Les déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL), issus du traitement des combustibles usés des centrales nucléaires : structures qui entourent les combustibles usés (coques et embouts) et effluents liquides issus du procédé de retraitement. Les déchets MA-VL constituent 3% du volume des déchets radioactifs, pour 4% de leur radioactivité.
* Les déchets de haute activité à vie longue (HA-VL) correspondent aux déchets issus du traitement des combustibles nucléaires usés : ils contiennent les « produits de fission » et les « actinides mineurs » formés par les réactions nucléaires dans le combustible lors de son séjour en réacteur. Leur durée de vie peut s'étendre sur plusieurs milliers, voire plusieurs millions d'années. Ils ne représentent que 0,2% du volume des déchets radioactifs mais 96% de la radioactivité totale des déchets radioactifs en France.
ENJEU :
ASSURER UNE GESTION DURABLE
DES DÉCHETS RADIOACTIFS
Les déchets radioactifs contiennent des radionucléides potentiellement dangereux pour l’homme et pour l’environnement. Ils doivent donc être gérés de manière spécifique tout au long de leur durée de nuisance potentielle : inventaire et collecte des déchets radioactifs, conditionnement adaptés, solutions de stockage sûres et pérennes.
Juridiquement, les grands principes de gestion des déchets radioactifs sont indiqués par la loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
Ces principes sont les suivants :
* protection de la santé des personnes et de l’environnement ;
* réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs ;
* prévention ou limitation des charges supportées par les générations futures ;
* principe pollueur-payeur qui prévaut en droit de l’environnement.
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) est l’organisme chargé de trouver, mettre en œuvre et garantir des solutions de gestion sûres pour l’ensemble des déchets radioactifs français.
Renouvelé tous les 3 ans, le plan national pour la gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR) constitue l’outil privilégié pour mettre en œuvre ces principes. Par ailleurs, tous les 3 ans, un inventaire complet des matières et des déchets radioactifs est réalisé et publié par l’Andra.
Aujourd’hui, 90 % des déchets nucléaires (en volume) produits en France disposent déjà d’une filière de gestion en stockage ultime. L’Andra dispose de centres dédiés de stockage et peut ainsi les gérer de façon industrielle : les déchets de très faible activité (TFA) sont stockés sur le site de Morvilliers (Aube), les déchets de faible et moyenne activité à vie courte (FMA-VC) sont stockés en surface sur le centre de Soulaines (dans l’Aube également).
Pour les déchets FA-VL, une démarche de recherche de site de stockage est conduite par l’Andra depuis 2008. En attendant la création d'un centre pouvant les accueillir, les déchets FA-VL sont entreposés dans des installations spécifiques, le plus souvent sur le lieu même où ils sont produits.
Enfin, les déchets de haute activité (HA) et de moyenne activité à vie longue (MA-VL) n’ont pas non plus de filière définitive de stockage. Dans l’attente d’un site de stockage définitif, ils sont conditionnés et entreposés dans des installations ad hoc par leurs producteurs, principalement à La Hague (Manche), Marcoule (Gard), Cadarache (Bouches-du-Rhône) et Valduc (Côte-d’Or). À terme, ils devraient être stockés sous terre, dans des formations géologiques de grande profondeur. C’est le projet Cigéo (Centre industriel de stockage géologique pour les déchets) de l’Andra, qui fait l’objet d’un débat public durant l’année 2013.
LES RECHERCHES SCIENTIFIQUES
SUR LES DÉCHETS RADIOACTIFS
La gestion des déchets radioactifs s’inscrit dans une démarche de progrès continu. Elle fait donc l’objet de programmes de R&D importants depuis la fin des années 1950, le but étant de minimiser la quantité de déchets, de concentrer la radioactivité et de garantir le confinement dans des conditions sûres.
Les déchets HA et MA-VL font l’objet de programmes de recherches particuliers dont les grandes orientations sont fixées par la loi du 28 juin 2006.
Cette loi définit trois axes de recherche et d’études complémentaires :
* La séparation/transmutation des actinides mineurs, sous la responsabilité du CEA : il s’agit d’isoler puis de transformer les éléments les plus radiotoxiques en les « transmutant » en d’autres éléments moins radiotoxiques et à vie plus courte. Ces recherches sont menées par le CEA en lien avec celles menées sur les réacteurs nucléaires à neutrons rapides de 4ème génération, capables de réaliser la transmutation. Le CEA a coordonné les travaux de recherche menés par les établissements publics (Andra, CEA, CNRS, Universités) et leurs partenaires industriels (Areva, EDF) afin d’évaluer les perspectives industrielles des technologies étudiées. Un dossier sur le résultat de ces travaux a été remis au gouvernement fin 2012.
Le stockage en formation géologique profonde (projet Cigéo en Meuse / Haute-Marne), sous la responsabilité de l’Andra : le stockage des déchets de haute et moyenne activité à vie longue en formation géologique profonde est retenu par la loi comme solution de référence. Cet axe de recherche correspond au projet Cigéo de l’Andra. Dans le domaine de la R&D, le CEA y contribue avec des études notamment sur le comportement à long terme des colis de déchets en milieu géologique profond et sur la migration des radionucléides dans les couches géologiques.
Le 3ème axe d’étude porte sur l’entreposage des déchets radioactifs HA et MA-VL en attente d’une solution de gestion définitive. Il est aussi confié à l’Andra. Le CEA a contribué à des études de conception de ces installations d’entreposage.
DOCUMENT cea LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Demain, l'hydrogène au quotidien ? |
|
|
| |
|
| |

L'HYDROGÈNE
Demain, l'hydrogène au quotidien ?
Des normes de sécurité pour la production, le stockage, le transport et les utilisations de l'hydrogène sont en cours d'élaboration.
Publié le 1 décembre 2013
La production d’électricité est possible en tout lieu et à tout moment grâce à la combinaison d’une pile à combustible et d’une réserve de dihydrogène.
UNE MISE EN PLACE PROGRESSIVE
Piles à combustible, réservoirs de stockage, véhicules, stations d’approvisionnement : de nombreux prototypes existent déjà. Les défis techniques, qui accompagnent l’usage du dihydrogène comme vecteur d’énergie, rendent nécessairement progressive son émergence dans nos vies quotidiennes. Pourtant, les modes de productions se diversifient, des solutions de transport et de stockage prennent forme et des utilisations variées voient actuellement le jour. En réponse à l’intermittence des énergies renouvelables, il équipera dans un avenir proche des maisons autonomes ou des villages isolés : si trop d’énergie électrique est produite grâce aux éoliennes ou aux capteurs solaires, le dihydrogène produit par électrolyse de l’eau la stocke sous forme chimique, pour la restituer grâce à une pile à combustible.
Source de courant privilégié, le dihydrogène peut désormais assurer la propulsion de véhicules électriques qui circuleront demain, dès lors qu’une distribution aussi performante que celle des hydrocarbures aura été déployée. Déjà des flottes de bus ou de véhicules utilitaires peuvent circuler autour d’un point unique de ravitaillement.
LE DIHYDROGÈNE EN TOUTE SÉCURITÉ
Très inflammable et nécessitant des conditions de stockage complexes (très basses températures ou très hautes pressions), le dihydrogène à usage énergétique est un combustible aussi dangereux que le GPL et nécessite le même type de précautions.
Jusqu’à ces dernières années, ce gaz n’était massivement utilisé que par l’industrie chimique. Son emploi futur en tant que vecteur d’énergie, ainsi que l’apparition de nouvelles techniques de production, de transport, de stockage et d’utilisation rendent nécessaires l’édiction de réglementations adaptées ainsi que la rédaction de normes spécifiant les caractéristiques techniques assurant la sécurité des usagers.
À l’échelle mondiale, le comité technique ISO1 TC 197 (auquel l’Afnor2 participe), créé en 1990, rédige des normes relatives aux différentes étapes d’utilisation du dihydrogène. Le comité technique IEC3 TC 105 s’occupe lui plus particulièrement des normes associées aux piles à combustible. Le réseau HYSAFE4 (auquel le CEA participe) contribue à l’élaboration de normes, de règlements et de guides de bonnes pratiques au niveau européen. Des directives européennes spécifiques aux applications stationnaires, mobiles et nomades sont régulièrement transposées en droit français.
Cet effort réglementaire et normatif s’appuie sur les travaux des principaux centres de recherche tels que le CEA qui réalise systématiquement des tests sur tous les dispositifs qu’il projette de développer ; comme par exemple des tests d’éclatement, de chute et de perforation sur les réservoirs haute pression.
DOCUMENT cea LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
La pile à combustible |
|
|
| |
|
| |

L'HYDROGÈNE
La pile à combustible
La pile à combustible représente un domaine potentiel de production d'électricité allant de quelques watts à des millions de watts.
Publié le 1 décembre 2013
UNE TECHNOLOGIE D'AVENIR DÉJÀ ANCIENNE
Le développement de la filière hydrogène repose en grande partie sur la technologie de la pile à combustible (PAC). Son principe n’est pas nouveau, puisqu’il fut découvert dès 1839 par William R. Grove. À l’époque, cet avocat anglais, chercheur amateur en électrochimie, constate qu’en recombinant du dihydrogène et du dioxygène, il est possible de créer simultanément de l’eau, de la chaleur et de l’électricité. La pile à combustible est née.
C’est Francis T. Bacon, ingénieur, qui réalisera, en 1953, le premier prototype industriel de puissance notable (de l’ordre du kW). Mais seule la Nasa exploitera cette technologie, dans les années 60, pour fournir en électricité certains de ses vaisseaux Gemini et Apollo
Car si le principe de la pile à combustible paraît simple, sa mise en œuvre est complexe et coûteuse, ce qui interdisait jusqu’alors sa diffusion dans le grand public. Aujourd’hui, des progrès ont été réalisés et les applications envisageables sont nombreuses. De la micro pile à combustible (microPAC), qui ne produit que les quelques watts nécessaires à l’alimentation d’un téléphone mobile, à la pile capable de produire 1 MW pour fournir de l’électricité à un immeuble collectif, en passant par la pile destinée aux applications embarquées, dans le secteur des transports, il en existe désormais toute une gamme. Le principe de fonctionnement est toujours le même, mais différentes technologies sont en développement suivant la nature du combustible envisagé (hydrogène ou méthanol, gaz naturel, ammoniaque, etc) et suivant la température de fonctionnement optimale.
Le fonctionnement d'une pile à combustible
LES DIFFÉRENTES FILIÈRES TECHNOLOGIQUES
Il existe plusieurs types de piles à combustible qui se différencient par leur électrolyte*. Celui-ci définit la température de fonctionnement et donc les applications. Plusieurs types de combustibles sont envisageables : dihydrogène, gaz de synthèse, gaz naturel, gaz issus de la biomasse, alcools. Selon l’origine du combustible, les piles à combustible peuvent, ou non, émettre des gaz à effet de serre. La R&D porte actuellement sur les améliorations techniques (compacité, rendement énergétique, résistance à l’usure, fonctionnement sur de nombreux cycles…) ainsi que sur la baisse des coûts de production.
* Les deux principales familles de piles à combustible étudiées au CEA sont : La pile à membrane échangeuse de protons (PEMFC) fonctionne aux alentours de 100 °C avec un électrolyte en polymère. C’est la plus prometteuse pour les transports, et la plus développée. On est actuellement au stade pré-industriel avec des coûts de l’ordre de 1 000 €/kW. L’enjeu des recherches est de faire passer ce coût en dessous de 50 €/kW. Deux variantes, la pile à méthanol direct et la pile à éthanol direct, consomment directement l’hydrogène contenu dans l’alcool. Très compactes, elles sont promises à l’alimentation de la micro-électronique (chargeurs) et de l’outillage portatif.
* La pile à oxyde solide (SOFC) est séduisante pour les applications stationnaires**, car sa température de fonctionnement très élevée (de l’ordre de 800 °C) permet d’utiliser directement le gaz naturel sans reformage. De plus, la chaleur résiduelle peut être exploitée à son tour directement, ou servir à produire de l’électricité par le biais d’une turbine à gaz. Dans ce cas, le rendement global (électrique et thermique) pourrait dépasser 80 %.
DOCUMENT cea LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
Le noyau du potassium perd de sa magie |
|
|
| |
|
| |

Le noyau du potassium perd de sa magie
Une nouvelle étude menée à ISOLDE révèle l’absence de signature d’un nombre « magique » de neutrons dans le potassium-51, ce qui remet en question le caractère magique supposé des noyaux à 32 neutrons
29 JANVIER, 2021 | Par Ana Lopes
Il semblerait que certains noyaux atomiques soient en train de perdre de leur magie. En effet, les dernières mesures de la taille des noyaux de potassium riches en neutrons ne révèlent aucune signature d’un nombre « magique » de neutrons dans le potassium-51, qui compte 19 protons et 32 neutrons. Ce résultat, obtenu par une équipe de recherche utilisant l’installation de physique nucléaire du CERN, ISOLDE, et présenté dans un article récemment publié dans la revue Nature Physics, remet en question certaines théories de la physique nucléaire et le caractère magique supposé des noyaux à 32 neutrons.
D’après la théorie, les protons et les neutrons occuperaient chacun une série de couches de différentes énergies au sein d’un noyau atomique, à l’instar des électrons qui remplissent dans un atome une série de couches de différentes énergies autour du noyau. Dans ce modèle nucléaire en couches, les noyaux dans lesquels les protons ou les neutrons forment des couches complètes, sans aucune place pour d’autres particules, sont qualifiés de « magiques », car ils sont plus fortement liés et plus stables que les noyaux voisins. On dit alors que le nombre de protons ou de neutrons dans ces noyaux est magique, et cette caractéristique est un élément fondamental de la connaissance des noyaux.
D’après de précédentes études, les noyaux contenant 20 protons, ou un nombre proche, et 32 neutrons, sont magiques compte tenu de l’énergie qu’il faut pour retirer une paire de neutrons du noyau ou pour porter le noyau à un niveau d’énergie supérieur. Cependant, des mesures de la variation subie par les rayons de charge des noyaux de potassium et de calcium riches en neutrons lorsqu’on leur ajoute des neutrons ont remis en question ce modèle : en effet, aucune diminution relative soudaine du rayon du potassium-51 et du calcium-52, qui ont tous deux 32 neutrons, n’a été mise en évidence. Une telle diminution, rapportée à celle mesurée pour des noyaux voisins qui ont moins de neutrons, indiquerait que 32 est un nombre magique de neutrons et que les noyaux de 32 neutrons sont donc magiques.
Une autre façon de mettre en évidence un nombre magique correspondant à 32 neutrons serait de mesurer une augmentation relative soudaine du rayon des noyaux qui ont un neutron de plus, soit 33 neutrons. C’est la voie de recherche qu’a voulu explorer l’équipe responsable de la toute dernière étude d’ISOLDE. En combinant deux méthodes différentes, l’équipe de recherche d’ISOLDE a pu mesurer le rayon des noyaux de potassium riches en neutrons et appliquer les données obtenues au potassium-52, qui compte 33 neutrons. La première méthode est une technique de spectroscopie laser appelée spectroscopie colinéaire par ionisation résonante (Collinear Resonance Ionisation Spectroscopy - CRIS), qui permet d’étudier avec grande précision les noyaux riches en neutrons. La deuxième méthode est la détection de la désintégration bêta, qui suppose la détection des particules bêta (électrons ou positons) émises par les noyaux.
Les nouvelles mesures obtenues par ISOLDE n’ont montré aucune augmentation relative soudaine du rayon du potassium-52, et donc aucun signe de « magie » au niveau du neutron numéro 32.
L’équipe de recherche a ensuite intégré les données dans des modèles s’appuyant sur des théories de physique nucléaire de pointe, et constaté que ces théories se trouvaient alors remises en question. « Les modèles de physique nucléaire les plus performants à ce jour ne sont pas capables de reproduire les données de manière satisfaisante », explique Agi Koszorus, auteur principal de l’article. « S’ils réussissent à reproduire correctement un aspect des données, ils passent totalement à côté du reste », ajoute Xiaofei Yang, co-auteure principale.
« Cette étude met en évidence les limites de notre connaissance des noyaux riches en neutrons, souligne Thomas Cocolios, co-auteur. Plus on étudie ces noyaux exotiques, plus on se rend compte que les modèles ne parviennent pas à reproduire les résultats des expériences. C’est comme avoir une carte routière qui indiquerait uniquement des autoroutes ; dès que vous prenez un autre chemin, eh bien vous êtes perdu ».
« Ce résultat montre que nous avons encore beaucoup à faire pour comprendre le noyau atomique. C’est probablement le domaine le moins bien connu de la physique », conclut Thomas Cocolios.
DOCUMENT cern LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|
